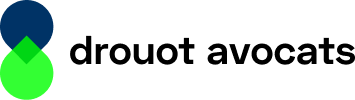Avocat en droit de l’agrivoltaïsme et du photovoltaïque
●Sites et sols pollués
●Autorisations environnementales
●Agrivoltaïsme
●Eolien
●Méthanisation

Vous envisagez de lancer un projet agrivoltaïque, mais les réglementations en la matière vous inquiètent ? Vous souhaitez garantir la viabilité juridique de votre parc tout en respectant les normes environnementales ? Chez Drouot Avocats, nos avocats spécialisés en droit de l’agrivoltaïsme et du photovoltaïque sont disponibles pour vous accompagner dans la sécurisation de vos installations.
L’agrivoltaïsme combine la production agricole et la production d’énergie solaire sur un même terrain. Quant au photovoltaïque, il est dédié à la production d’électricité solaire. Ces deux secteurs, en plein essor, représentent des opportunités uniques pour allier production énergétique et optimisation des terres agricoles.
Avocat spécialisé en droit de l’agrivoltaïsme et du photovoltaïque pour comprendre les nouvelles règles applicables
Avec l’énergie éolienne qui se déploie, les paysages français changent. Depuis plus de deux décennies, la transition énergétique transforme le territoire. Une nouvelle étape débute : le développement des projets agrivoltaïques et photovoltaïques au sol. Jusqu’en 2023, le droit encadrant ces projets était clair. Les autorisations d’urbanisme suivaient un régime classique.
Le droit a évolué pour s’adapter aux nouveaux modèles de production et lever les obstacles au développement des projets. Les textes européens et nationaux se sont multipliés, mais le cadre législatif et réglementaire de l’agrivoltaïsme reste inachevé. Heureusement, la loi APER a vu le jour en mars 2023.
Elle a ajouté à l’article L. 100-4 du Code de l’énergie un objectif clair. Celui-ci vise à « encourager la production d’électricité issue d’installations agrivoltaïques », tout en conciliant cette production avec l’activité agricole. La priorité reste la production alimentaire, tout en évitant les effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles. La loi APER n’offrait pas un cadre juridique complet pour mettre en œuvre ces objectifs.
Le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024, d’application de la loi APER, et l’arrêté du 5 juillet 2024 sur l’agrivoltaïsme et l’implantation des installations sur terrains agricoles, naturels ou forestiers, sont donc intervenus. Bien que d’autres textes soient attendus, la loi, le décret et l’arrêté forment le socle principal du cadre juridique de l’agrivoltaïsme. Il est utile de faire un point sur les contours de ce régime juridique.
En effet, les élus, les administrations, les associations, les citoyens et même les porteurs de projets se perdent souvent dans ce cadre légal. Le législateur adopte une approche typologique pour encadrer les installations. Il considère leur nature et leur implantation. Actuellement, les projets photovoltaïques au sol suivent différentes procédures. Ils doivent respecter les règles d’urbanisme de leur lieu d’implantation.
Nos avocats spécialisés en droit de l’agrivoltaïsme et du photovoltaïque agissent comme des experts juridiques pour décrypter les évolutions législatives et réglementaires, notamment celles issues de la loi APER. Nous vous expliquons les impacts des nouvelles lois et textes sur vos installations agrivoltaïques. Nous assistons les parties prenantes (élus, associations, citoyens, porteurs de projets) pour s’adapter à ces évolutions.
Avocat spécialisé en droit de l’agrivoltaïsme et du photovoltaïque pour déterminer la procédure applicable à votre projet
Un projet photovoltaïque ou agrivoltaïque nécessite une décision d’urbanisme. D’autres autorisations spécifiques peuvent être demandées.
Le régime des autorisations d’urbanisme
Les parcs photovoltaïques peuvent nécessiter une déclaration préalable ou un permis de construire. Cela dépend de la capacité de production installée en kilowatt-crête (kWc). Depuis le décret n° 2022-970 du 1er juillet 2022, les installations supérieures à 1 MWc nécessitent un permis de construire, une évaluation environnementale systématique et une enquête publique.
Pour celles dont la capacité de production se situe entre 300 kWc et 1 MWc, il faut une déclaration préalable. Elles peuvent être dispensées d’une étude d’impact après examen au cas par cas. Quant aux installations comprises entre 3 kWc et 300 kWc ou inférieures à 3 kWc avec une hauteur de plus de 1,80 m, elles nécessitent une déclaration préalable et une participation du public par voie électronique (PPVE).
Elles sont exemptées d’examen au cas par cas, sauf si des incidences notables sont signalées dans les 15 jours suivant la déclaration. Les installations de moins de 3 kWc et d’une hauteur inférieure à 1,80 m sont exemptées d’autorisation d’urbanisme. Elles peuvent faire l’objet d’un examen au cas par cas si le pouvoir instructeur le décide.
En revanche, le régime applicable diffère si le projet se situe dans un « secteur protégé » au sens de l’article R421-11 du Code de l’urbanisme :
- un site patrimonial remarquable (SPR) ;
- les abords d’un monument historique ;
- un site classé ;
- une réserve naturelle ;
- ou un cœur de parc national.
Dans ce cas, les installations de moins de 3 kWc nécessitent une déclaration préalable et les autres sont toutes soumises à la délivrance d’un permis de construire.
La délivrance d’autorisations complémentaires
Les parcs photovoltaïques ne disposent pas d’un système d’autorisation unique. Chaque aspect du projet requiert des décisions administratives adaptées. Outre l’autorisation d’urbanisme, d’autres décisions peuvent être nécessaires pour valider une installation, comme l’autorisation de défrichement ou la dérogation espèces protégées.
Un projet photovoltaïque nécessite une autorisation de défrichement s’il implique la suppression d’espaces boisés, mettant ainsi fin, directement ou indirectement, à la vocation forestière des lieux. Ce défrichement est obligatoire au-delà d’un seuil départemental, compris entre 0,5 et 4 hectares. La loi APER limite désormais les parcs impliquant un défrichement. Depuis le 11 mars 2024, les installations entraînant un défrichement de plus de 25 hectares, auparavant soumises à une évaluation environnementale, sont interdites.
Dans certains cas, l’autorisation de défrichement est conditionnée par une évaluation environnementale. L’article L341-5 du Code forestier énumère les cas où l’autorisation est refusée, notamment en cas de perturbation de la qualité des eaux, de déséquilibre biologique local, de risque d’érosion côtière ou d’impact sur la sécurité et la salubrité publique.
En tant qu’avocats spécialisés en droit de l’agrivoltaïsme et du photovoltaïque, nous facilitons l’identification des démarches administratives requises pour obtenir les autorisations nécessaires à votre projet. Notre équipe identifie le type d’autorisation requis (déclaration préalable, permis de construire, etc.) et vérifie la conformité de votre projet selon sa localisation (secteur protégé, zone agricole, etc.). Nous gérons aussi les interactions avec les administrations compétentes.
Avocat spécialisé en droit de l’agrivoltaïsme et du photovoltaïque pour identifier la catégorie de votre installation
Les installations photovoltaïques en zone agricole sont classées en deux catégories. La première catégorie concerne les installations agrivoltaïques, telles que définies à l’article L.314-36 du Code de l’énergie. Celles-ci peuvent être implantées en zone agricole. Quant à la seconde catégorie, elle concerne les installations compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière. Leur installation est soumise à un cadre beaucoup plus strict.
Selon la loi APER, une installation est considérée comme agrivoltaïque si elle apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, tout en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique, gérée par un établissement spécifique, une production agricole significative et un revenu durable :
- l’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;
- l’adaptation au changement climatique ;
- la protection contre les aléas ;
- l’amélioration du bien-être animal.
Ne sont pas considérées comme des installations agrivoltaïques, celles qui ne permettent pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ou celles qui ne sont pas réversibles. Les caractéristiques techniques des installations doivent garantir qu’elles n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, notamment ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ni son potentiel agronomique.
De plus, l’installation ne doit pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière. Notre cabinet d’avocats spécialisés en droit de l’agrivoltaïsme et du photovoltaïque vous assiste dans la distinction et la classification de vos installations en fonction des critères légaux. Notre équipe d’experts en droit de l’environnement et des énergies renouvelables s’assure aussi que le parc agrivoltaïque respecte les normes environnementales.
Contrôles des installations agrivoltaïques
Les articles 6 et 7 du décret du 8 avril 2024, ainsi que l’article 4 de l’arrêté du 5 juillet 2024 ont établi les modalités de suivi et de contrôle des installations, ainsi que les sanctions en cas de non-conformité. Par exemple, pour les projets agrivoltaïques, ainsi que les zones témoins, les contrôles prévus sont les suivants :
- un contrôle préalable à la mise en service ;
- un contrôle à la 6e année de la mise en service ;
- un rapport détaillant les travaux de démantèlement et de remise en état du site, comportant un relevé technique du terrain.
Ces contrôles sont effectués par un organisme scientifique, un institut technique agricole, une chambre d’agriculture ou un expert foncier et agricole.
L’article 4 de l’arrêté du 5 juillet 2024 précise le contenu du rapport de contrôle, afin de vérifier le respect des conditions prévues par le Code de l’énergie et le Code de l’urbanisme. Des contrôles supplémentaires sont prévus pour certaines installations, tels que des contrôles tous les trois ans pour celles dont le taux de couverture est inférieur à 40 %, et annuellement pour les autres installations.
L’exploitant doit également fournir chaque année les informations nécessaires sur la production énergétique et agricole de la parcelle à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect de ces obligations, comme l’absence de transmission du rapport annuel ou l’absence de démantèlement ou de remise en état du site.
Chez Drouot Avocats, notre équipe conseille et défend les exploitants face aux obligations de contrôle et aux éventuelles sanctions prévues par la loi. Nous vous préparons aux contrôles préalables et périodiques, etc.). Nos avocats spécialisés en droit de l’agrivoltaïsme et du photovoltaïque réagissent en cas de contentieux liés à la non-conformité de votre installation.